« Au cœur des Brigades internationales »

office universitaire de recherche socialiste: L’OURS L’Ours 532, novembre-décembre 2023
Ces deux témoignages de combattants écrits à chaud, ou presque, ont été retrouvés par historien Édouard Sill dans les microfilms des archives des Brigades internationales à la Contemporaine (Nanterre), les originaux étant dans les archives de Moscou. Ils restituent la période octobre 1936-avril 1937. 122 pages12€
Ces témoignages de cadres communistes éclairèrent la réalité du combat des interbrigadistes et de la vie à l’arriére. IIs ont été rédigés à la demande d’André Marty. Philippe dit Pierre Rebiére est né en 1909. Tour à tour forgeron, employé, chômeur, il meurt en 1942, fusillé après avoir reconstitué l’appareil du parti et aider à fonder l’OS. l’ancêtre de, FTP. Il a adhéré au PCF vers 1934. Sans que l’on sache pourquoi ni comment, il devient vite un homme de confiance de la direction du Parti. Ers 1936. Il participe aux négociations avec les ministres espagnols Largo Caballero et Diego Martinez Barrio sur les conditions de création des Brigades internationales. Blessé en février 1937, il commence alors à écrire cette histoire du 2e bataillon de la XIe brigade qui traverse les Pyrénées début octobre 1936 et arrive à Albacete le 11 octobre, salué par une foule qui dénonce la non-intervention française et acclame l’URSS. André Marty les accueille sur la base puis Rebiére organise les volontaires. Il est ensuite désigné commissaire politique de la Brigade, s’adjoignant plusieurs autres commissaires pour les compagnies. Trés vite, il monte au front à la Cité universitaire d’abord. Dés les première, heures. des combattants tombent. Il décrit l’âpreté des combats, les journée, d’attente. les permission, Il s’autorise même quelques critiques sur la presse du Parti, expliquant que L’Humanité, bluffe pour répondre à la presse fasciste. Il décrit l’enthousiasme des combattants quand d’autres arrivent ou quand un hiérarque leur rend visite comme Maurice Thorez. Blessé lors de la bataille de Jarama, c’est sur son lit d’hôpital qu’il rédige ce texte. Marcel Sagnier a un itinéraire proche. Lui aussi né en I909 mais son adhésion au mouvement communiste est plus précoce. Il entre à la CGTU en 1929. Peintre en bâtiment, c’est un bagarreur : il a eu a plusieurs reprise maille à partir avec les forces de l’ordre. En 1934. il devient employé municipal. Prisonnier en 1940. il n’a plus qu’un rôle secondaire après la guerre, jusqu’à sa mort en 1962. Il part en Espagne le 10 octobre 1936 et est désigné comme commandant du bataillon Commune de Paris. Son parcours est légèrement différent. Sagnier est un combattant. Il rapporte avec minutie les affrontement à la Cité universitaire, la montée au front à Jarama puis la bataille de Guadalajara. Son récit s’interrompt alors qu’il est nommé à la tête du nouveau bataillon de francophone La Marseillaise. Des documents importants où, dans le, deux cas, la méfiance vis-à-vis des autres senaibilités politiques est de mise. Ils ne disent quasiment rien des conditions de recrutement mais saluent l’enthousiasme des volontaires, souhaitant avant tout montrer une réalité de l’engagement des volontaires en Espagne. Par Sylvain Boullouque.
« Une institutrice engagée dans l’Espagne républicaine »
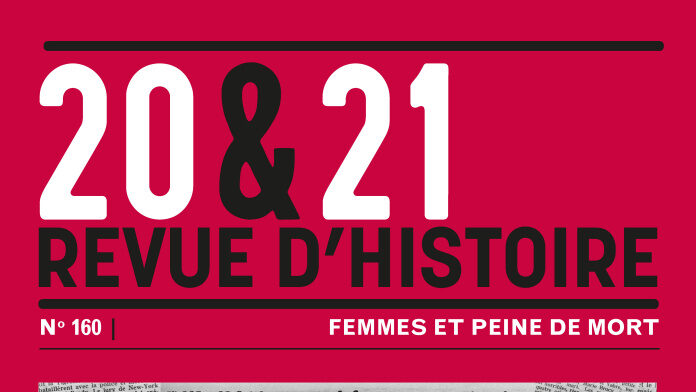
20 & 21. Revue d’histoire Presses de Sciences Po 2023/4 N° 160 20 & 21 signale
Institutrice et inspectrice d’académie en Algérie, militante anticoloniale et militante communiste, syndicaliste et pionnière de la pédagogie Freinet, Lisette Vincent (1908-1999) était aussi une activiste féministe et homosexuelle. Si les multiples dimensions de cette infatigable militante étaient relativement connues grâce à sa biographie signée Jean-Luc Einaudi (Un rêve algérien. Histoire de Lisette Vincent, une femme d’Algérie, Paris, PUF, 2001), son parcours espagnol l’était moins. Car Lisette Vincent fut aussi volontaire dans les Brigades internationales. Le témoignage qu’elle avait rédigé en 1939, dès sa démobilisation, sur sa fonction d’institutrice dans un home d’enfants des Brigades internationales en Catalogne est exceptionnel. Il nous restitue tout d’abord le quotidien et l’action des volontaires de l’arrière-front, qui fut souvent celui des femmes internationales. Il est aussi et surtout le journal d’une pédagogue qui applique auprès des petits orphelins espagnols les techniques Freinet de l’école ouverte, participative, où l’enfant fait ses propres expériences, et ce malgré la barrière réciproque de la langue. Lisette Vincent a interpolé dans son récit des pages de son cahier d’observation de la classe, en laissant souvent la parole aux écoliers eux-mêmes. Cette parution s’inscrit dans l’entreprise de publication de témoignages inédits de vétérans français des Brigades internationales par l’association mémorielle des Amis des volontaires en Espagne républicaine, accompagnée par l’historien Edouard Sill comme directeur scientifique. (Lisette Vincent, Histoire d’une colonie d’enfants espagnols. Une institutrice dans les Brigades internationales, édition critique établie par Edouard Sill, Angers, Zeitgeist Éditions, 2023, 120 p., 12 €)
« La Naissance des Brigades internationales, âpres combats »

Slate.fr 4 février 2024 à 11h02
Le pronunciamiento de Franco le 19 juillet 1936 a soulevé une contre-insurrection, une partie des Espagnols étant attachés aux libertés acquises depuis 1931. Très vite, en même temps que la guerre, une révolution sociale éclate: les terres et les usines sont en partie mises en commun. La défense de la République et la lutte contre le fascisme suscitent un élan de solidarité internationale. Dès la fin du mois de juillet 1936, des volontaires se rendent en Espagne, mais c’est fin septembre que les communistes organisent ce que la postérité retient comme étant le symbole de la lutte antifasciste: les brigades internationales. Les deux témoignages écrits à chaud –ou presque– par Pierre Rebière et Marcel Sagnier ont été retrouvés par l’historien Édouard Sill dans les microfilms des archives des Brigades internationales à la Contemporaine, les textes originaux demeurant dans les archives de Moscou. Dans ces notes, les deux combattants restituent la période allant d’octobre 1936 à avril 1937. Ils éclairent et restituent la réalité du combat des interbrigadistes et de la vie à l’arrière. Ils ont été rédigés conformément aux souhaits d’André Marty, le responsable du Parti communiste français (PCF), dépêché à Albacete à la demande de l’Internationale communiste. Tous deux ont été des cadres communistes. Philippe, dit Pierre Rebière, est né en 1909. Tour à tour forgeron, employé, chômeur, il meurt en 1942, fusillé après avoir reconstitué l’appareil du parti et aidé à fonder l’Organisation spéciale, l’ancêtre des Francs-tireurs et partisans (FTP). Il adhère au PCF vers 1934, sans que l’on sache pourquoi ni comment, et devient vite un homme de confiance de la direction du Parti. En 1936, il participe aux négociations avec les ministres espagnols Francisco Largo Caballero et Diego Martínez Barrio pour les conditions de création des Brigades internationales. Blessé en février 1937, il commence alors à écrire cette histoire du deuxième bataillon de la XIe brigade. Il traverse les Pyrénées début octobre 1936. Tous deux arrivent à Albacete le 11 octobre, salués par une foule qui dénonce la non-intervention française et acclame l’URSS. André Marty les accueille sur la base, puis Pierre Rebière organise les volontaires. Il est ensuite désigné commissaire politique de la Brigade, s’adjoignant plusieurs autres commissaires pour les compagnies. Très vite, ils montent au front à la Cité universitaire d’abord. Dès les premières heures, des combattants tombent. Pierre Rebière décrit l’âpreté des combats, les journées d’attente, les permissions. Il s’autorise même quelques critiques sur la presse du Parti, expliquant que L’Humanité bluffe pour répondre à la presse fasciste. Il poursuit son récit en décrivant l’enthousiasme qui saisit les combattants quand un hiérarque communiste leur rend visite, à l’image de Maurice Thorez. Blessé lors de la bataille du Jarama, c’est sur son lit d’hôpital qu’il rédige ce texte.
« En Espagne avec le bataillon Commune de Paris, au cœur des affrontements »

Slate.fr 4 février 2024 à 11h02
Marcel Sagnier a un itinéraire proche. Lui aussi est né en 1909, mais son adhésion au mouvement communiste est plus précoce. Il entre à la Confédération générale du travail unitaire (CGTU) en 1929. Peintre en bâtiment, c’est un bagarreur: il a eu à plusieurs reprises maille à partir avec les forces de l’ordre. En 1934, il devient employé municipal –prisonnier en 1940, il n’a plus qu’un rôle secondaire après la guerre jusqu’à sa mort en 1962. Il part en Espagne le 10 octobre 1936 et est désigné comme commandant du bataillon Commune de Paris. Son parcours est légèrement différent; Marcel Sagnier est un combattant. Il rapporte avec minutie les affrontements: la cité universitaire, la montée au front à Jarama, puis la bataille de Guadalajara. Son récit s’interrompt alors qu’il est nommé à la tête du nouveau bataillon de francophones, La Marseillaise. Pierre Rebière et Marcel Sagnier offrent des documents importants où, dans les deux cas, la méfiance vis-à-vis des autres sensibilités politiques est de mise. Ils ne disent quasiment rien des conditions de recrutement, mais saluent l’enthousiasme des volontaires, dont ils souhaitent avant tout montrer la réalité de l’engagement.